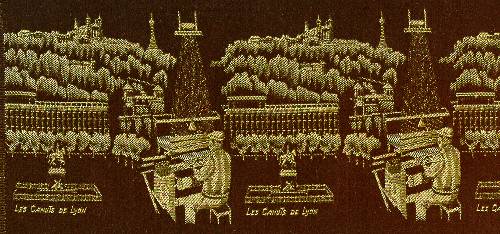|
 |
 |
 |
La Maison des Canuts |  |
||||||||
La Maison des Canuts a vocation de maintenir les traditions, les usages, les coutumes et les gestes de ces tisseurs.
Fondée en 1960, COOPTISS est une coopérative d'artisans salariés à domicile. Nos ateliers familiaux de la Loire, de la Haute-Loire, du Rhône et de l'Isère, maintiennent un savoir-faire de grande qualité, dont la tradition fut développée pour les fabricants de Lyon et de la Haute Couture. En 1970, COOPTISS crée la Maison des Canuts, lieu désormais incontournable où l'histoire vivante du tissage se prolonge dans une activité commerciale, contribuant à la promotion de la soie.
Cadeau d'entreprise : tradition et personnalisation
COOPTISS s'impose aujourd'hui comme un spécialiste du carré personnalisé et du peint main.
Le carré personnalisé est réalisé en fonction d'une thématique d'actualité ou à la demande spécifique des entreprises. Chaque projet est d'abord esquissé par un dessinateur de talent. Les premiers jets, systématiquement soumis à nos clients, permettent avec leur collaboration, d'affiner peu à peu la solution et de proposer les produits les mieux adaptés à leurs exigences.
L'impression est réalisée au cadre à la main, une technique traditionnelle permettant d'assurer précision et finesse d'exécution.
Le peint main répond à une toute autre technique. Auteur du carré, le peintre choisit les motifs et les couleurs qu'il applique mais il est également possible de lui passer des commandes précises. Ainsi, quelle que soit la quantité, chaque carré peint main reste un exemplaire unique, signé par l'artiste.

La Maison des Canuts : l'avenir du passé
Lieu de découverte, animé par l'esprit de la Croix-Rousse, la Maison des Canuts a vocation de maintenir les traditions, les usages, les coutumes et les gestes de ces tisseurs qui contribuèrent à établir la renommée de Lyon et de la soierie dans le monde. A ce titre, les salles d'exposition permettent de suivre l'évolution technologique du tissage, du métier à la grande tire au métier de velours, de la mécanique Jacquard à la mécanique Verdol.
Une exposition de tissus anciens permet à un public toujours plus nombreux, de connaître et d'apprécier le tissage des étoffes de qualité, en particulier la soie.
Plus qu'un Musée, la Maison des Canuts est un lieu de dialogue et de rencontre avec des produits dont on aura compris la complexité et la valeur. Cravates, carrés, foulards, écharpes, portraits et tableaux tissés composent toute une gamme de cadeaux personnels à des prix très compétitifs.
Aujourd'hui, la Maison des Canuts est une signature, c'est aussi une marque déposée.
Dépositaire des secrets des tisseurs de soie, d'or et d'argent lyonnais, la Maison des Canuts est le conservatoire vivant des arts de la soie.
Du cocon au velours de Gênes ou au Damas, dans le labyrinthe de la soierie, la Maison des Canuts dévide le fil de la soie et guide le visiteur à travers l'histoire et les techniques de cette fibre merveilleuse découverte il y a 4.500 ans par une princesse chinoise.
Du métier à la tire de Philippe de Lassalle du XVIIIe, aux métiers de velours, de la mécanique Jacquard du XIXe à la mécanique Verdol du XXe, les salles d'exposition permettent de suivre l'évolution technologique du tissage.
Collections de tissus anciens et de passementerie, accessoires et outils des ouvriers tisseurs, démonstrations sur métiers manuels et mécaniques font de la Maison des Canuts le lieu idéal pour comprendre ce qui fait la richesse et la qualité des étoffes de soie.
Des canuts tissent encore à la main des étoffes de prestige, sauvegardant les usages, les coutumes et les gestes des artisans d'autrefois.
Etoffe noble aux reflets chatoyants, la soie se colore d'une palette somptueuse, des teintes les plus vives aux pastels les plus tendres. Imprimée ou peinte à la main elle se pare de riches motifs ou d'artistiques tableaux. Façonnée, elle conjugue reliefs et couleurs pour créer les plus belles étoffes du monde. Tournée vers l'avenir, vers la haute-couture et les productions artistiques, la soie attend, sereine, le IIIe millénaire.
La Maison des Canuts
Musée du Tissage de la soie "Jacquard"....les Traboules Lyonnaises....
Le mot "traboule" essentiellement lyonnais, vient du latin transbulaire (aller à travers). Trabouler, c'est communiquer d'une rue à l'autre en traversant plusieurs immeubles par des couloirs et des cours. La connaissance des traboules permet de mettre en pratique un principe fondamental de la "plaisante sagesse lyonnaise" : "le vrai du vrai, c'est pas tant d'aller vite, mais de savoir par où passer". De nombreuses et curieuses traboules permettent de se rendre de la Croix-Rousse au Vieux-Lyon en passant par les Terreaux et le quartier Mercière-Saint Antoine.
A partir de la Maison des Canuts : rejoindre la Place Colbert...
... du 9 place Colbert au 29 rue Imbert Colomès...
... 20 rue Imbert Colomès au 55 rue des Tables Claudiennes...
... passage Mermet au 27 rue René Leynaud...
... 22 rue des Capucins au 5 rue Coustou...
... 2 rue Romarin au 26 rue des Capucins...
... 8 petite rue des Feuillants au 19 place Tolozan...
... 33 rue Royale au 16 quai André Lassagne...
... 15 quai André Lassagne au 31 rue Royale...
... 2 petite rue des Feuillants au 5 rue du Griffon...
... 12 rue Pizay au 9 rue de l'Arbre Sec...
... 8 rue du Plâtre au 23 rue Longue...
... 22 rue Longue au 5 rue de la Fromagerie...
... 20 rue Paul Chenavard au 29 rue Lanterne...
... 10 rue Chavanne au 3 place d'Albon...
... 44 rue Mercière au 21 quai Saint-Antoine...
... 38 rue de Brest au 49 rue Mercière...
... 58 rue Mercière au 27 quai Saint-Antoine...
... 30 quai Saint-Antoine au 64 rue Mercière...Traversez ensuite le pont Maréchal Juin
... 17 rue des Trois Maries au 20 quai Romain Roland...
... 4 rue de la Baleine au 11 quai Romain Roland...
... 10 quai Romain Rolland au 2 place du Gouvernement...
... 24 rue Saint-Jean au 1 rue du Boeuf...
... 63 rue Saint-Jean au 3 rue des Antonins...
... Maison du Soleil au pied du Gourguillon.

L'origine de la soie
établi d'après un cours de tissage - Lyon 1881L'art d'élever le ver à soie et de dévider le cocon pour en extraire le fil, paraît avoir été découvert par SI LING CHI, femme de l'Empereur HOANG-TI, 2.690 ans avant Jésus-Christ.
Dans ces temps reculés, l'insecte vivait à l'état sauvage, sur les mûriers, abandonné aux seuls soins de la nature ; les cocons étaient filés en bourre pour des tissus grossiers et des cordes sonores pour instruments de musique.
Ma reconnaissance du peuple chinois a placé cette impératrice au rang des Génies : elle est honorée sous le nom d'"Esprit du mûrier et des vers à soie".
Les Livres Sacrés dans lesquels CONFUCIUS (500 ans av. J.C.) a réuni les annales de la Chine, mentionnent fréquemment la soie et établissent incontestablement que l'industrie séricicole a été maintenue sans discontinuité dans cette contrée isolée de la Chine Orientale.L'exportation des graines était sévèrement interdite, c'est pourquoi la production de la soie fut longtemps limitée à cette nation.
Les soieries, uniquement réservées pour la Cour, sous le règne des Empereurs, jusqu'à près de 1.000 ans av. J.C., servaient à la confection des étendards, des parasols et pour les cérémonies religieuses, pour les Grands ou Officiers de l'Empire, dont les couleurs varées étaient les signes distinctifs de rang et de dignité.
Près de vingt siècles s'écoulèrent ainsi, avec peu de progrès. Vers le 9e siècle av. J.C., l'Empereur pour se distinguer, adopta des vêtements de soie. C'est LI WANG, 878 av. J.C. qui, le premier, suivant M. Pauthier, osa porter des habits de soie de couleur jaune, richement ornés.
Dès lors, le fabricant s'efforce de donner à l'étoffe l'aspect le plus extraordinaire ; la production ne suffit plus : l'Empereur organise, dans son Palais, un atelier où il réunit les artistes les plus habiles pour y faire fabriquer ces merveilleuses étoffes ; il encourage la production de la soie ; une plantation de mûriers est entretenue dans les jardins du Palais ; auprès d'elle, une magnanerie pour y élever l'insecte producteur, sous les soins de l'Impératrice. La culture de la soie prend de l'extension et se propage dans diverses contrées de l'Empire.
Bientôt, elle devient abondante par des soins encouragés sous un climat favorable.
C'est au 3e siècle av. J.C. seulement que les Chinois commencèrent à livrer au reste de l'Asie, au Japon, à l'Inde et à la Perse, la soie décreusée, c'est-à-dire dépouillée de son grès, afin de diminuer son poids pour faciliter l'exportation, et surtout pour la dénaturer afin de dissimuler sa provenance.
C'est de guerres d'Alexandre contre les Perses (350 ans av. J.C.) que date l'introduction de la soie en Grèce, par des officiers qui en apportèrent des fragments.
Les victoires de Pompée amenèrent à Rome la connaissance de la soie au commencement du 1er siècle av. J.C.
La Perse fut longtemps le marché où s'approvisionnaient les Grecs et les Romains ; des caravanes apportaient de SERIQUE, contrée de l'Inde, la soie d'où l'on sut, pour la première fois du temps de Polonias, qu'elle venait. Les Latins l'appelaient SERICON, d'où vient le nom de SOIE.
Au 3e siècle de notre ère, les villes de Tyr et Béryte en Phénicie, commencèrent à fabriquer des étoffes de soie, puis Byzance, au 4e siècle ; elles tiraient avec peine des soies de la Perse qui en avait le monopole.
A cette époque, la vigilance des Chinois fut mise en défaut par des émigrants qui transportèrent au Japon des graines de vers à soie chinois. Ils apprirent l'art de les élever et de dévider les cocons. Cette industrie passa bientôt dans l'Inde Orientale où l'insecte existait à l'état sauvage, ainsi que le mûrier ; on y filait les cocons, mais à l'état de bourre ; c'est de là sans doute que nous est venu cette belle race de cocons jaunes.
Avant le 4e siècle, le Japon, l'Inde et la Perse fabriquaient des soieries, mais avec la soie chinoise.
La source de cette nouvelle industrie ne devait pas rester plus longtemps inconnue à l'Europe. Au 6e siècle, deux moines persans, qu'une mission dans l'Inde avait mis à même, en trompant la surveillance des peuples parmi lesquels ils passaient, d'étudier cette production, apportèrent à la fin de l'année 552 de notre ère à l'Empereur Justinien, des oeufs en graines qu'ils avaient cachés et conservés dans des cannes en bambou qui leur servaient de bâtons de pélerins.
Ils firent éclore et élever, avec des feuilles du mûrier qui était connu principalement en Grèce où on le cultivait surtout en haies ; ils démontrèrent comment on dévidait les cocons pour en obtenir cette soie fine et brillante, tant enviée qui, jusque là, était amenée à grands frais et devenue pas sa rareté d'un prix très élevé. L'étoffe se vendait au prix de l'or.
Justinien fit propager la culture du mûrier, ainsi que la récolte des cocons ; il fit établir à Constantinople et dans plusieurs villes de ses états, des manufactures de soieries en tous genres.
Les procédés de fabrication furent bientôt répandus en Arabie et en Grèce.
Maitresse du commerce de la Méditerranée et en relations avec le Levant, Venise eut longtemps le monopole du trafic de ces riches étoffes.
Les Arabes ne tardèrent pas à transporter cette heureuse découverte sur les côtes de l'Afrique et en Espagne où ils dominaient.
Vers l'an 1130, Roger, Roi des Deux-Siciles, ayant à son retour de la Terre Sainte, fait la conquête de plusieurs villes de la Grèce, amena avec lui dans ses Etats, un grand nombre d'ouvriers. Il favorisa leur établissement à Palerme et dans d'autres villes du royaume, où il fit aussi propager la culture du mûrier et l'éducation des vers à soie.
A mesure que l'on sut se procurer une récolte plus abondante et que se généralisa le luxe, les manufactures de soieries se multiplièrent dans la plupart des villes d'Italie.
Les Papes, dont le luxe dépassait celui des rois, encouragèrent aussi cette industrie qui fit longtemps la richesse du pays.
En 1309, le pape Clément V, français d'origine, mécontent du peuple italien, transféra le Saint Siège à Avignon ; la magnificence des gens de sa cour éveilla en France le goût des vêtements somptueux. Cette cour appela les ouvriers de la Sicile et aida elle-même à l'établissement des premières manufactures de soie dans la ville d'Avignon, qui s'éleva à un haut degré de prospérité.
En 1470, Louis XI fit venir à Tours des ouvriers d'Italie et leur accorda de grands privilèges, sous la conduite de François le Calabrais ; on organisa dans cette ville des fabriques qui furent renommées pour la fabrication des étoffes unies, dites "gros de Tours", ainsi que des façonnés, articles pour ameublement et des damas, étoffe riche qui fut longtemps apportée en France de la ville de Syrie d'où elle a tiré son nom.
Il y avait à Lyon, depuis longtemps, des ouvriers en soie, ce que démontrent les lettres patentes de Louis XI, du 24 mai 1466, mais les métiers étaient en petit nombre et produisaient peu ; on ne peut les considérer, même de 1466 à 1636, que comme des essais peu encouragés.
En 1536, François 1er étant à Lyon, la municipalité sollicita ses privilèges ; il agréa une requête importante : ses lettres patentes permettaient aux ouvriers d'Italie et de tous les pays, de venir habiter Lyon pour y travailler aux étoffes de soie. Il organisa alors des ateliers en tous genre et Lyon vit augmenter rapidement sa population et sa prospérité. On y comptait déjà en 1544 : 12000 ouvriers à divers titres employés à la fabrication des étoffes de soie.
En 1600, Henri IV et son ministre Sully favorisèrent la culture et l'industrie de la soie en France ; en peu de temps, sous les soins d'Ollivier de Serre, plus de 400000 pieds de mûrier furent plantés dans le Midi, le Dauphiné, le Lyonnais et même aux environs de Paris. Le Roi encouragea par des récompenses l'établissement de fabriques de soieries à Paris, qui furent longtemps dans un état prospère et qui s'y sont maintenus pour certains articles, tels que gazes, châles, etc.
Louis XIV et Colbert continuèrent cette oeuvre de progrès ; les manufactures en tous genres, notamment celles en soieries, prirent une grande extension. Lyon acquit une réputation qui l'éleva au premier rang des villes manufacturières.
En 1620, un ouvrier de Lyon, nomme DANGON, inventa le métier à la tire pour les grand façonnés. Lyon devint célèbre par la fabrication de ses étoffes de soie qui furent exportées dans le monde entier.
La Révocation de l'Edit de Nantes, en 1685, porta un coup funeste à l'industrie française, principalement à la soierie : 500000 ouvriers et négociants émigrèrent en emportant leur art et leur industrie à l'étranger. Tours vit sa fabrique presque anéantie ; celle de Lyon et Avignon en furent paralysées.
La peste qui, en 1782, enleva 30000 personnes de la population d'Avignon, porta un coup mortel à cette ville qui, longtemps, a cessé d'être un centre de production.
Nimes profita des dépouilles de l'ancienne Cité des Papes pour organiser des entreprises qui sont aujourd'hui peu importantes.
Au XVIIIe siècle, les fabriques se ranimèrent et prirent une grande extension. Mais ce ne fut qu'au commencement du XIXe siècle, à partir de 1810, que celles de Lyon et de St-Etienne (pour les rubans) prirent un nouvel essor. La mécanique dite "JACQUARD" qui a remplacé la grande tire a puissamment contribué au développement des façonnés.
Actuellement (en 1881), cette industrie est à peu près répandue dans tous les pays manufacturiers de l'Europe et même en Amérique ; mais Lyon – qui occupe environ 200000 métiers dans l'intérieur et ses environs – conserve toujours la supériorité sur ses rivales pour la grande production, la perfection et la richesse des étoffes de soie en tous genres.
JACQUARD 1752 - 1834
Hommage à Jacquard
présenté lors d'une manifestation devant sa statue,
place de la Croix-Rousse, le 25 juillet 1970,
par les Compagnons du Tour de FranceA l'occasion de notre Fête traditionnelle, nous tous, Compagnons du Tour de France, désirons rendre hommage à l'illustre ouvrier que fut JACQUARD et qui devint Grand-Maître, reflétant ainsi l'exemple d'un idéal parfait ne pouvant être servi que par des hommes tels que lui, possèdant une certaine valeur morale et professionnelle.

Enfant, il avait déjà le goût du métier, ayant l'exemple d'une famille vouée au dur labeur qu'était celui de tisserand. Il ne pensa qu'à soulager les efforts des siens et à améliorer leur existence. Son instinct de chercheur, son naturel inventif, jouèrent en quelque sorte malgré lui.
Adolescent, il perfectionna plusieurs outils dont se servaient les typographes. Il inventa une machine qui devait améliorer le sort des ouvriers. Mais, hélàs, ce fut une première et imprudente entreprise qui lui attira l'incompréhension, l'hostilité des employeurs et voire même des travailleurs.
Mais se vie était ailleurs.
Malgré ses déboires encore tout récents, il revint peu après au tissage familial dont il s'était écarté pour des raisons de santé. C'est là que ses dons innés s'exercèrent avec plénitude. Il avait entre temps pu apprendre à lire, à compter, à écrire. Il se plongea désormais dans des lectures instructives. Il observa plus lucidement. Il caressa son projet, mais il ne put encore rien : l'heure n'était pas venue.
En 1775, il fut frappé par la mort de son Père.
C'est à cette époque qu'il recruta des Compagnons, monta une modeste fabrique de tissu façonné. Il obéit ainsi d'un élan naturel à ses réactions de bon artisan qui rêvait de faire honnêtement sa carrière. Ce fut son premier mobile : s'établir et suivre l'exemple de ses aînés.
En 1777, il prit femme. Ce fut un mariage d'amour qui lui donna un enfant qu'il sut élever en lui inculquant les bons principes d'une enfance et d'une adolescence sobres et laborieuses.
Puis, vint la Révolution. En 1791, JACQUARD fut enrôlé avec son fils de quinze ans et envoyé aux avant-postes où il fut nommé Sergent et combattit avec vaillance. La République ayant repoussé les assauts, JACQUARD fut libéré. Il regagna LYON. La maison qu'il habitait deux ans plus tôt et où il avait laissé sa femme avait été détruite, comme tant d'autres. Il dut se mettre à la recherche de Mme JACQUARD, et la découvrit dans un grenier du faubourg où elle menait une existence misérable. Minée par une longue inquiétude, affaiblie par les privations, elle ne supporta pas le coup ressenti en apprenant la mort de son fils, et s'éteignit à son tour.
En présence de cette nouvelle détresse, JACQUARD fit appel à tout son courage. L'excès de malheur même lui donna des forces. Il se sentit de taille à lutter. On avait besoin de bras et JACQUARD trouva aisément à s'employer.
Son existence à peu près réorganisée, ses heures de travail prudemment consacrées à gagner sa vie matérielle, il passa le plus clair de ses soirées à calculer, à construire, à expérimenter.
L'une des préoccupations du bon ouvrier a toujours été d'améliorer son outil. JACQUARD, lui, n'eut d'autre dessein, et c'est ce qui le distingua du savant qui invente.
L'homme qui invente, applique son esprit de recherche à la machine elle-même, à sa précision, à son rendement. L'ouvrier qui améliore son outil s'efforce d'en faire un instrument plus souple entre ses mains habiles, plus apte à un travail de qualité. Ce n'est pour lui qu'un moyen. Le but, c'est l'ouvrage à réaliser. Pour l'atteindre, il écarte de cet outil tout ce qui l'alourdit, ralentit ses réactions, tout ce qui ne correspond pas à un jeu de l'intelligence ou de la sensibilité.
Telle fut l'œuvre de JACQUARD.
Pendant six années, il médita, lutta, peina obscurément dans son petit logement de la rue de la Pêcherie. S'il fut encouragé par certains, il fut aussi découragé par un plus grand nombre.
C'est en 1801 qu'enfin le fruit de son travail lui valut une première récompense : la Médaille de Bronze à "l'Exposition des Produits de l'Industrie Nationale". Loin d'être satisfait, il améliora la mécanique de son métier à tisser. Le 26 décmebre 1801, il obtint le Brevet d'Invention, établi par la loi du 7 janvier 1791, des mains du Ministre de l'Intérieur par Intérim, Monsieur CHAPTAL.
Mais notre inventeur lyonnais, qui avait conscience de l'imperfection de cette première machine, se réserve de la modifier. Fort peu soucieux de ses intérêts matériels, comme il le prouva à maintes reprises, il ne s'occupa jamais d'exploiter son Brevet.
Si relative que fut cette réussite, elle aurait pourtant fait connaître le nom de JACQUARD et attiré l'attention sur l'humble Canut qu'il était.
En 1802, l'Autorité Municipale proposa à JACQUARD de l'héberger au Palais St Pierre, l'ancien couvent laïcisé par la Révolution, pour y instruire des apprentis et former des Compagnons en échange de cette hospitalité. JACQUARD accepta et sans la moindre rétribution. Il fit même des avances pécuniaires, jamais remboursées, pour l'achat de fournitures et de matériel. Il s'acquitta de cette tâche, laquelle au demeurant, cadrait avec ses idées d'artisan convaincu.
Ses qualités inventives ne s'endormirent pas pour autant. Le 2 février 1804, sous l'autorité ministérielle, monta à PARIS avec sa mécanique où il obtint une première Médaille d'Or.
L'incompréhension dont il fut victime l'affecta profondément, mais n'abattit pas son courage, car il fut malgré tout soutenu par des fabricants, ce qui en fin de compte lui fit obtenir la victoire. C'est en effet par l'intermédiaire d'un industriel, Monsieur ZACHARIE, que le métier à tisser de JACQUARD fut adopté et qu'il supplanta à LYON tous les anciens procédés.
La célébrité que lui valut son invention lui amena bien des reconnaissances et grand nombre d'amis, mais il ne dissimulait pas sa joie quand il trouvait par hasard en face de lui un interlocuteur qui pénétrait dans le secret de la technique. Alors, il lui parlait de son œuvre, son visage se transformait, ses yeux prenaient un éclat plus vif, sa voix se faisait plus expressive ; pour quelques instants, il redevenait l'artisan passionné de son métier, l'artisan génial qui avait métamorphosé les règles de son Art.
En 1819, le Roi LOUIS XVIII le fit Chevalier de la Légion d'Honneur.
Les gens s'étonnaient de voir JACQUARD si simple. Plein de reconnaissance pour tous ceux qui lui voulaient du bien, il oublia de plus en plus les tracasseries, les mauvais procédés, les injures et les injustices dont il avait été victime.
Il s'éteignit le jeudi 6 août 1834.
Ainsi, le rêve du modeste artisan lyonnais a été magnifiquement réalisé. Après plus d'un siècle, l'outil perfectionné par lui, répondant avec souplesse à l'agilité des mains, à la mobilité de l'Esprit Français, continue à servir les tisseurs, ses frères, et à produire en abondance de belles choses, des ouvrages de qualité.
Il fut tout au long de sa vie, un homme droit, loyal, sincère, probe et il a laissé à jamais dans nos esprits l'image d'un vrai Compagnon.
Puisse son souvenir demeurer vivant au sein de notre idéal commun et servir d'exemple aux Jeunes.
21 octobre 1831...
Brandissant le drapeau noir... la canuserie dépavait la Croix-Rousse, allait à la bataille de rues et mourait dans la Grand'Côte pour six sous sur une aune de satin...Novembre (Brumaire) est le mois maléfique de Myrelingues-la-Brumeuse, où les superstitions flottent dans le brouillard. On meurt dans la nuit du 12 novembre 1930 (catastrophe de Fourvière) et près d'un siècle auparavant, la mort plus brutale encore ; celle qu'on se donne d'homme à homme, rôdait sur les pentes surpeuplées de la Croix-Rousse. Au dernier jour de Brumaire, 21 octobre 1831, commençait la révolte des canuts, celle qu'on appela les "journées glorieuses" du prolétariat lyonnais.
Si le drapeau noir à tête de mort, qu'on devait plus tard appeler "la guenille", apparut à LYON, ce fut l'effet d'un jaillissement spontané. On comptait alors 165000 lyonnais et la ville, qui était la deuxième du royaume, pouvait rivaliser avec MANCHESTER dans l'importance de la production textile.La "Canuserie" ou classe des tisseurs selon le mot du maître ouvrier CHARNIER, fondateur de la Société secrète et pro-révolutionnaire que fut à l'époque le "Devoir Mutuel", comprenait les 8000 canuts "riches" de deux à six métiers sur lesquels ils travaillaient avec la femme, les gosses et les "compagnons". Ceux-ci étaient bien 30000 dans LYON, guère plus pauvres que leur patron, mangeant à sa table et couchant souvent au-dessus du métier, à côté de la "Mécanique à JACQUARD""gone" qui était le "tireur".
Partageant le même sort, puisque le compagnon touchait la moitié des prix de façon et quelquefois les deux-tiers quand ceux-ci étaient réduits à l'extrême par le fabricant, maîtres et ouvriers formaient le peuple des canuts.
Le travail mal payé des enfants et des femmes aggravait le mécontentement.
Pourtant, sous l'Empire et la Restauration, une période de prospérité avait amélioré les conditions de vie.
Et puis ce fut le marasme, en dépit de l'ouverture du marché américain. Les négociants invoquaient déjà la concurrence étrangère. A ZURICH, à LONDRES, à BERLIN et à MOSCOU, disaient-ils, on travaille à meilleur compte et ils baissaient le prix à l'aune. En 20 ans, le prix de façon de la "levantine" était tombé de 1,30 franc à 60 centimes, celui du satin de 1 franc à 10 sous et celui du reps, de 2,50 francs à 1 franc. La prison de St Paul était pleine de canuts condamnés pour dettes et la mère du Commissaire, le futur député, dut vendre un jour sa belle chevelure pour 15 francs à un perruquier de la rue des Capucins.Le 18 octobre 1831, le Préfet BOUVIER-DUMOLARD avait reçu les délégués des chefs d'ateliers (on disait alors députés) venus lui présenter leurs pétitions et lui demander son arbitrage à propos de l'établissement d'un tarif des prix de façon. Ce tarif fut mis en discussion avec les représentants de la fabrique, le 25 octobre.
Ce jour-là, six mille canuts "sans armes et sans bâtons" organisés en "centuries" et en "décuries", envahirent la place Confort (les Jacobins de nos jours) et se massèrent devant la Préfécture d'alors. Après quatre heures d'âpres discussions, le tarif fut signé et la foule des manifestants et des curieux se retira en acclamant le Préfet.
Mais la rue des Capucins qui était le quartier général des "soyeux" allait réagir. Bientôt les négociants refusèrent d'appliquer le tarif devenu exécutoire le 1er novembre, puis, en dépit des nouvelles commandes, refusèrent le travail. Certains fermèrent leurs magasins, répondant aux menaces de grèves par le lock-out. Car la grève était décidée pour le lundi 21 novembre. La veille, le dimanche, avait lieu place Bellecour, une revue de la Garde Nationale en l'honneur de la prise de commandement du Général ORDONNEAU et l'on s'aperçut que malgré la pauvreté de leur uniforme, les canuts et les ouvriers formaient la majorité des 10000 présents.
Dès 7 heures du matin, le lundi 21 novembre, LYON et surtout la Croix-Rousse est en état de siège. Les cinq portes d'accès à la Croix-Rousse sont gardées chacune par 50 hommes. Un bataillon de la Garde Nationale et 300 soldats occupent la place de la Croix-Rousse, tandis que 5 autres bataillons sont tenus en réserve, ainsi qu'un poste d'infanterie et un de cavalerie, à l'Hôtel de Ville. Toute la garnison est en alerte.
De leur côté, les compagnons organisent la grève. En groupe, ils parcourent les ateliers, font sortir ceux qui travaillent encore et coupent les fils ou les pièces de soieries sur les métiers des réfractaires. Au son lugubre du tambour, la foule grossit de plus en plus, désarme quelques gardes nationaux et sillone la Croix-Rousse en tous sens, sous les plis du drapeau noir, symbole de deuil, dont l'un porte, selon MAZON, une tête de mort et la devise : "Vivre en travaillant ou mourir en combattant".La guerre civile va commencer.
Les triques, les débris de chaises et les pierres ont bientôt raison d'un piquet de la 1ère Légion de la Garde, recruté chez les négociants et commandé par le capitaine ZINDEL, qui essayait de s'installer place des Bernardines.
Il est établi que c'est le détachement de la 1ère légion qui ouvrit le feu sans sommation, sur la manifestation hurlante qui descendait la Grande Côte. Exasperés, les frabricants mitraillent la foule du carrefour de la Grande Côte et de la rue Vieille Monnaie (aujourd'hui rue René Leynaud). Dix hommes sans armes sont à terre et il y a trois morts...
A leur tour, les canuts affluent précipitamment sur le plateau qui devient un camp retranché, hérissé de piques et de fusils derrière ses barricades. On promène les cadavres dans les rues et la Garde Nationale désarmée a dû livrer ses deux pièces qui serviront d'obstacles puisqu'elles n'ont pas de munitions.
Des munitions, on en trouve pour les fusils, en coulant dans des dés à coudre le plomb enlevé aux "jacquards". La place de la Croix-Rousse est dépavée et les tas de pierres sont autant de dépôts de munitions pour les manifestants qui monteront les pavés sur les toits où les tuiles sont arrachées. Les femmes et les enfants travaillent aux barricades.
Du côté des forces de l'ordre, la contre-attaque est contrariée par la défection d'une grande partie des effectifs prévus la veille. Des gardes quittent leur bataillon et courent répandre l'alarme : "On veut désarmer l'ouvrier ! Nous irons défendre nos camarades de la Croix-Rousse". De plus les canons étaient restés à l'arsenal et les munitions à la poudrerie...
A midi, un bataillon du 66e de ligne et un autre de la Garde Nationale commandé par PREVOST, enlèvent une barricade montée St Sébastien par la caserne des Colinettes. Une autre colonne gravit la Grande Côte avec, à sa tête, le Préfet BOUVIER-DUMOLARD et le Général ORDONNEAU, tous deux en grand uniforme. On parlemente. Le Préfet et le Général acceptent de se rendre à la Mairie de la Croix-Rousse où BOUVIER-DUMOLARD se met au balcon pour haranguer la foule qui crie en réponse : "Du travail ou la mort".
Soudain on entend le grondement du canon et la fusillade reprend de trois côtés à la fois. On crie à la trahison. Une triple offensive à la Grande Côte, montée de la Boucle et montée St Sébastien, s'était déclenchée contre les canuts, au beau milieu des appels au calme du Préfet.
Quand le jour se leva le 22 novembre, deux faits importants s'étaient déroulés avant l'aube. Le Général ROGUET avait reçu des renforts, ce qui portait ses effectifs à près de 5000 hommes et on en attendait encore 12000 de l'artillerie de VALENCE, de GRENOBLE et de BESANCON. Aussi, dans une déclaration très ferme, affirmait-il que les fauteurs de trouble et d'anarchie étaient confondus.
Dans le même temps, Anthelme LECLERC, à la tête d'une centaine d'ouvriers des Brotteaux et de la Guillotière franchit le Rhône sur une digue à la tombée de la nuit, évitant ainsi la garde du pont, passa le pont de la Mulatière, Choulans, St Just, Chamvert, Rochecardon, l'Ile Barbe et parvint à 5 heures du matin à la Croix-Rousse par la montée de Cuire avec 350 gaillards recrutés en route, une route de vingt kilomètres.
Une attaque du 13e de ligne contre une barricade place Rouville, vers la maison aux trois cents fenêtres, se heurta à une défense victorieuse des insurgés.Et maintenant, ce sont les canuts qui attaquent. De nouveaux fronts s'ouvrent sur le Rhône et la rive droite de la Saône. Après avoir pillé trois armureries et brûlé les octrois, les ouvriers des Brotteaux tirent sur le quai St Clair, tandis que le tocsin sonne dans les églises, en branle-bas de combat pour les canuts.
Le Général ROGUET répond en faisant tirer sur les Brotteaux, sans empêcher 500 ouvriers qui ont forcé le pont Lafayette, de pousser une pointe vers la mairie. Le télégraphe de Fourvière tombe aux mains des insurgés qui prennent le pont de la Guillotière à midi, le pont Tilsitt deux heures plus tard, puis le passage de l'Argue, le quai des Célestins, la rue Mercière...
A minuit, la Garde Nationale, forte de 15000 hommes, s'est dispersée ou est passée aux émeutiers. Les soldats de ligne et les dragons ne tiennent plus qu'un quadrilatère limité par les deux fleuves, la place des Terreaux, la rue Neuve.BOUVIER-DUMOLARD, le Préfet qui avait su garder l'estime des canuts, n'aura aucune peine à repousser l'idée d'un gouvernement provisoire avancée par la fraction sociale du parti républicain. Les canuts se seront battus pour leur tarif, un tarif qui leur sera d'ailleurs arraché, le 7 décembre. Quatre jours avant, en effet, le Docteur PRUNELLE, le Maire absent de LYON au moment des émeutes, mais qui avait voté avec FULCHIRON, une adresse réclamant la répression, recevait en l'Hôtel de Ville, le Duc d'Orléans et l'Etat-Major de l'armée du Maréchal SOULT, forte de 30000 soldats.
Les canuts avaient perdu la partie.
Il ne restait plus alors qu'à jouer le dernier acte : le jugement des meneurs.
Bilan de ces trois journées terribles : beaucoup de sang pour un tarif que personne ne verra affiché, beaucoup de sang et de souffrance pour du pain qu'on n'a pas eu !...
Encombrés de leur victoire sans lendemain, les canuts n'ont gardé de ces trois journées qu'une poignante complainte subversive et désuète.
Seuls témoins possibles de cette tragédie : les vieux métiers à bras qui, à la Croix-Rousse s'arrêtent de battre parce que l'on ne sait plus travailler dessus ou qu'ils ne nourrissent plus leur homme.
Et aujourd'hui, le carré des canuts, de ceux qui héritèrent leur savoir des insurgés de 1831, s'en va en s'amenuisant jusqu'au jour où le dernier des "bistanclaques" sera parti pour 12 francs le kilog. chez le "casseur" des métiers à tisser.
Mais la révolte des canuts de 1831 demeure comme la première manifestation du Parti des Travailleurs.